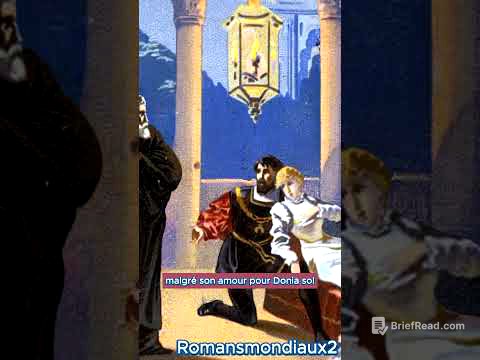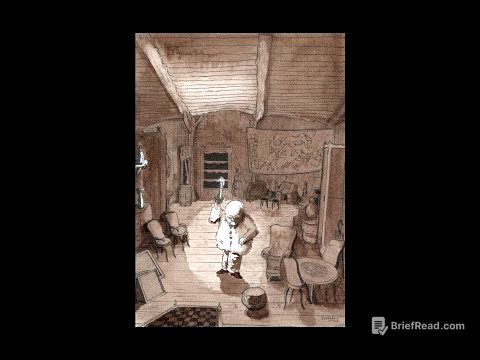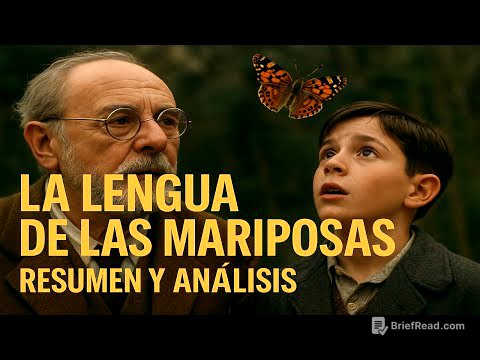Bref Résumé
Cette vidéo explore le développement des villes au Moyen-Âge, en mettant en lumière les facteurs de leur essor, l'organisation de la vie urbaine et les inégalités sociales. Elle aborde le rôle du commerce, l'importance des corporations, et l'acquisition progressive d'autonomie par les villes.
- Croissance urbaine due à la paix, l'augmentation de la population et des productions agricoles.
- Rôle clé du commerce et des foires dans le développement économique des villes.
- Société urbaine divisée en trois classes : le peuple gros, le peuple menu et les pauvres.
- Corporations comme structures encadrant les métiers et assurant qualité et stabilité des prix.
- Acquisition d'autonomie par les villes grâce aux chartes de franchise et symbolisée par des bâtiments comme l'hôtel de ville et le beffroi.
L'essor des villes au Moyen-Âge [0:05]
Au début du 11e et 12e siècles, seulement 10% de la population européenne vit dans les villes, mais ce chiffre atteint près de 20% au 13e siècle. Cet essor est dû à une période de paix en Europe, combinée à une croissance démographique et à une augmentation des productions agricoles. Les villes deviennent des centres d'échange de marchandises, favorisées par le développement du commerce, notamment grâce aux grandes villes portuaires comme Gênes, Venise et Bruges, qui commercent avec d'autres puissances étrangères par voie maritime. Les foires, grands marchés spécialisés, attirent également populations et marchands de divers horizons, tandis que les villes situées au carrefour de routes commerciales importantes prospèrent grâce aux importations et exportations.
Organisation de la vie urbaine : marchands, artisans et inégalités [1:55]
La ville médiévale est un centre d'activité pour les marchands et les artisans, dont la richesse dépend de leur capacité à commercer localement ou avec des contrées lointaines. Les plus riches de ces marchands échangent avec les grandes villes du royaume ou des puissances étrangères. Ces marchands et artisans vivent grâce aux marchés urbains, et beaucoup possèdent des boutiques et ateliers au rez-de-chaussée de leur habitation, où ils vendent des produits variés comme la laine, le coton, la soie, des vêtements, des tabourets et parfois même des arbres. Les artisans, tels que les tailleurs et les cordonniers, contribuent à structurer la ville et à enrichir sa communauté. La société urbaine est très inégalitaire, divisée en trois groupes : le peuple gros (grands marchands et artisans riches qui détiennent le pouvoir), le peuple menu (petits artisans, marchands et travailleurs salariés souvent en opposition avec le peuple gros) et les pauvres (qui vivent de mendicité).
Les corporations et l'apprentissage [4:33]
Les artisans ont la possibilité de rejoindre une corporation, une association de personnes exerçant le même métier. Les corporations garantissent la qualité des produits, limitent la concurrence des prix et restreignent le nombre de personnes pouvant exercer le métier. Pour intégrer une corporation, il faut suivre un apprentissage : l'apprenti travaille pendant sept ans, nourri et logé par un maître artisan qui lui transmet son savoir. Après cette période, l'apprenti devient compagnon, un travailleur salarié. Le compagnon peut ensuite devenir maître en réalisant un chef-d'œuvre et en obtenant l'autorisation des membres de la corporation.
Autonomie urbaine et symboles de pouvoir [6:09]
Les villes cherchent à gagner en autonomie vis-à-vis du seigneur en obtenant des chartes de franchise. Bien que le seigneur conserve la propriété de la ville, il délègue une grande partie de sa gestion aux représentants de la cité, généralement les grands marchands. La charte de franchise accorde des droits et des devoirs à la population et à ses représentants. L'autonomie de la ville est symbolisée par des bâtiments tels que l'hôtel de ville (la mairie), un sceau (pour authentifier les documents) et un beffroi (une tour symbolisant l'autonomie). L'enrichissement des villes permet la construction de grands bâtiments comme les cathédrales.
Conclusion [7:21]
En résumé, les villes attirent de plus en plus de populations et créent une société inégalitaire, mais dynamique. Le dynamisme urbain offre des opportunités, notamment l'accès à la formation avec l'apparition d'écoles et d'universités, permettant aux populations d'accéder au savoir.