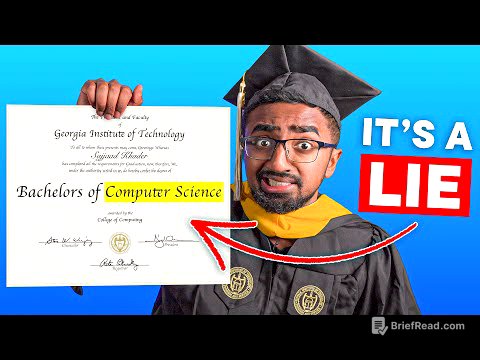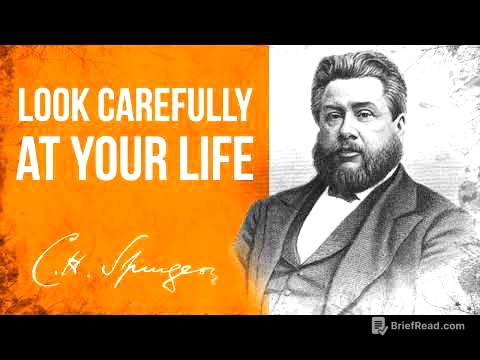Bref Résumé
Cette vidéo sert d'introduction au programme de Philosophie, Littérature et Humanités (HLP) pour les classes de première et terminale. Elle met en lumière la structure du programme, qui est divisée en deux intitulés généraux par semaine, chacun exploré à travers trois entrées spécifiques. La vidéo souligne l'importance d'intégrer des références littéraires et philosophiques pour une compréhension complète du programme. Elle explique comment les thèmes abordés en HLP complètent le programme de philosophie du tronc commun, offrant ainsi une préparation plus efficace pour les épreuves.
- Le programme HLP est structuré autour de deux intitulés généraux par semaine, divisés en trois entrées chacun.
- Chaque entrée est enrichie par des références littéraires et philosophiques.
- Les thèmes abordés en HLP sont complémentaires à ceux du tronc commun en philosophie.
Introduction [0:00]
La vidéo présente le programme de HLP pour les classes de première et terminale, en mettant l'accent sur la manière dont les fiches de cours seront structurées pour couvrir l'ensemble du programme. Chaque semaine, deux intitulés généraux seront explorés, chacun divisé en trois entrées. Pour chaque entrée, une fiche vidéo présentera une problématique et des références littéraires et philosophiques pertinentes. L'objectif est de fournir un cours cohérent qui intègre à la fois la philosophie et la littérature, en soulignant les liens entre les deux disciplines. De plus, la vidéo met en évidence la complémentarité entre les thèmes abordés en HLP et ceux du tronc commun en philosophie, ce qui permet aux élèves de progresser simultanément dans les deux matières.
I. La recherche de soi [2:38]
Ce chapitre introduit le thème de la recherche de soi, en retraçant son évolution à travers différentes périodes historiques. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, l'individu était soumis à une autorité extérieure, qu'il s'agisse de la communauté, de Dieu ou des religions instituées. Cependant, à partir de la Renaissance, un bouleversement se produit avec l'émergence de la science moderne et la remise en question des anciennes croyances. L'individu prend de plus en plus d'importance, et la raison humaine devient le guide vers la vérité. Cette évolution culmine au siècle des Lumières, où les notions de liberté et d'égalité se développent, conduisant à des révoltes contre les systèmes monarchiques. Le chapitre annonce l'analyse de cette notion sous trois aspects : éducation, expressions de la sensibilité et métamorphoses du moi.
I.A Education, Transmission, Emancipation [5:37]
Ce segment explore le paradoxe de l'émancipation à travers l'éducation et la transmission du savoir. Il souligne que, bien que l'émancipation vise à libérer l'individu de toute autorité, l'accès au savoir nécessite un guide, un maître. L'éducation est ainsi présentée comme un processus d'élévation vers le savoir, où l'élève s'élève grâce à un maître. La vidéo compare l'instinct animal, qui ne nécessite aucune transmission, à la culture humaine, qui repose sur l'accumulation et la transmission de savoirs. Elle illustre comment le savoir humain s'accumule et progresse au fil des générations, dépassant les capacités individuelles. L'éducation est également présentée comme un remède contre la violence, permettant à l'homme de se libérer des rapports de violence du monde animal.
I.B Les expressions de la sensibilité [14:44]
Ce chapitre explore la sensibilité au cœur du romantisme, en présentant une histoire de l'art selon Hegel, qui passe par trois stades : l'art symbolique, l'art classique et l'art romantique. L'art symbolique, représenté par les pyramides égyptiennes, cherche à impressionner le spectateur par un édifice monumental. L'art classique, avec les Grecs, recherche l'harmonie et la beauté. Cependant, Hegel estime que l'art romantique dépasse ces stades en mettant l'accent sur l'expression de la subjectivité humaine, des sentiments et des passions. La vidéo illustre cette idée avec des exemples de musique et de littérature romantiques, soulignant comment la souffrance et le désespoir peuvent être sublimés en beauté. Elle distingue également le beau de l'agréable, en expliquant que le plaisir esthétique est désintéressé et spirituel, contrairement au plaisir corporel.
I.C Les métamorphoses du moi [24:11]
Ce segment aborde la question de l'identité personnelle et de la stabilité du moi. Il commence par présenter la perspective de Descartes, qui affirme que la seule vérité indubitable est l'existence de notre propre esprit, exprimée par le cogito "je pense donc je suis". Cette idée marque un changement de mentalité par rapport à l'Antiquité et au Moyen Âge, où l'individu était soumis à la communauté ou à la religion. La vidéo souligne également l'importance de l'autobiographie, avec Rousseau, comme expression de l'individualité. Cependant, elle critique ensuite l'idée d'un moi bien délimité, en s'appuyant sur les travaux de Freud, qui montre que les frontières du moi ne sont pas stables, notamment chez le nourrisson. Elle illustre cette idée avec des exemples de maladies mentales et de relations amoureuses, soulignant comment les frontières du moi peuvent être floues ou trop rigides.