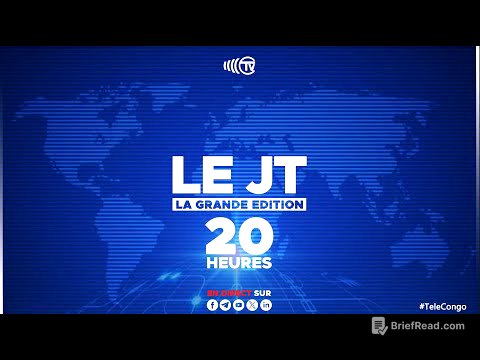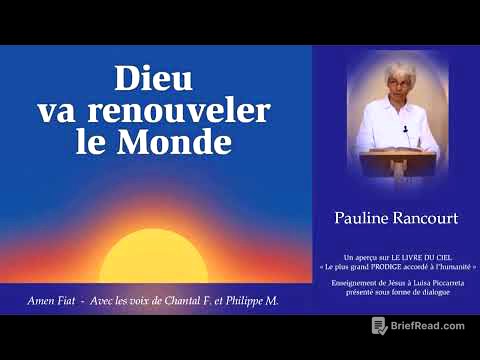Résumé
Cette vidéo retrace l'expansion et le déclin du califat omeyyade, de sa consolidation après la deuxième fitna à son apogée territoriale et culturelle, puis aux révoltes et invasions qui ont marqué le début de son recul. Les points clés incluent la centralisation du pouvoir sous Abdal Malik, les conquêtes en Afrique du Nord, en Espagne et en Asie centrale, ainsi que les défis internes et externes qui ont conduit à son affaiblissement et à l'ascension des Abbassides.
- Consolidation du pouvoir et expansion territoriale sous les Omeyyades.
- Défis internes (révoltes) et externes (invasions) menant au déclin.
- Importance de la Gizia et des conversions dans l'expansion musulmane.
L'ascension des Omeyyades et la deuxième Fitna [0:19]
En 661, Muawiya, gouverneur de Damas, prend le titre de calife après sa guerre contre Ali, fondant la dynastie omeyyade. Après les troubles de la première fitna, l'expansion du califat reprend vers le Maghreb. Les Arabes avancent près de Carthage et fondent Kairouan en Tunisie vers 670. La flotte engage un long siège de Constantinople en 674, mais échoue en raison des défenses byzantines et du feu grégeois. La situation intérieure reste fragile, et à la mort de Muawiya en 680, son fils Yazid lui succède, ce qui provoque des révoltes et une nouvelle division du territoire, marquant la deuxième fitna.
Consolidation du califat sous Abdal Malik [1:14]
Après une succession de califes, Abdal Malik restaure l'autorité omeyyade sur l'ensemble du califat en 692. Pour contrôler ce vaste territoire, il nomme des émirs, gouverneurs de province dotés de pouvoirs civils et militaires importants. Il crée également le corps des cadis, juges chargés d'appliquer le droit musulman, et frappe sa propre monnaie, le dinar, remplaçant les monnaies byzantines et perses.
Expansion territoriale et défis [1:52]
La dynastie omeyyade est ainsi renforcée, permettant une nouvelle expansion. Le contrôle de Chypre est consolidé et la conquête du Maghreb se poursuit, avec la prise de Carthage en 695 et de toute la province byzantine trois ans plus tard. Les Arabes progressent ensuite vers l'ouest, aux dépens des tribus berbères indépendantes du Maroc actuel, achevant la conquête en 709. Les populations conquises, majoritairement chrétiennes à l'ouest et zoroastriennes à l'est, doivent payer la Gizia en échange de leur non-participation à la guerre, ce qui entraîne des conversions massives et alimente les armées musulmanes.
Conquête de l'Espagne et avancée en Asie [2:47]
En 711, les Arabes musulmans, appuyés par des Berbères convertis, engagent la conquête du royaume wisigoth au nord de Gibraltar. L'armée royale est écrasée, mais il faut une dizaine d'années pour achever la conquête jusqu'en Septimanie. Certaines résistances locales perdurent, notamment dans les Asturies, d'où partira la Reconquista. Simultanément, le califat s'étend vers l'Asie, conquérant le Sind, la Sogdiane et le Khwarezm en 713, et gagne du terrain en Anatolie aux dépens des Byzantins.
Apogée et premiers revers [3:44]
Le califat omeyyade atteint son apogée, symbolisé par l'achèvement de la grande mosquée de Damas en 715. Le successeur d'Al-Walid tente de prendre Constantinople en 717, mais échoue. Les musulmans tentent ensuite de progresser en Europe occidentale, mais subissent des revers et se contentent de pillages. Le territoire du califat cesse de s'étendre à partir de 720.
Déclin et révoltes [4:19]
Les années 730 sont marquées par des invasions de peuples turcs, difficilement réprimées, notamment les Khazars au nord du Caucase et les Turcophones d'Asie centrale. Le recul du califat commence en 739 avec une révolte berbère au Maroc, qui rejette l'autorité omeyyade et se répand rapidement avant d'être stoppée devant Cordoue et Kairouan en 743. Les califes ne parviennent pas à restaurer leur autorité sur les territoires perdus, qui se couvrent de petits États berbères indépendants, favorisant un soulèvement qui portera la dynastie abbasside au pouvoir.