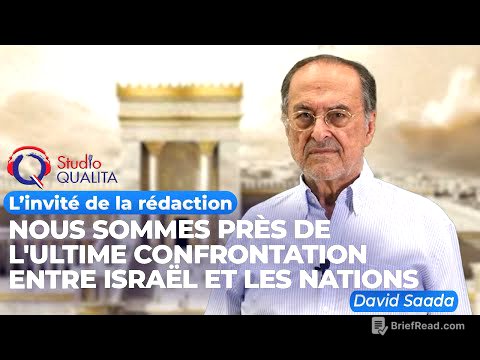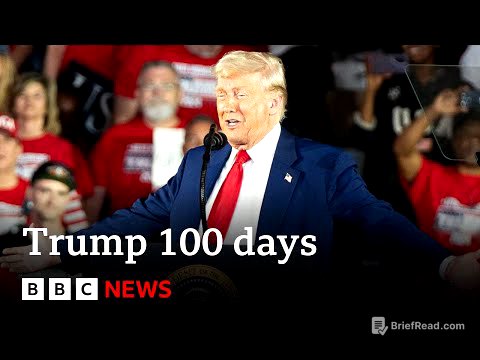Bref Résumé
Cette vidéo explique les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production. Elle aborde la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, en expliquant comment les différences de dotations factorielles et technologiques entre les pays mènent à la spécialisation et au commerce. De plus, elle examine les raisons pour lesquelles les pays comparables échangent des biens, notamment la différenciation des produits, les différences de qualité et la fragmentation de la chaîne de valeur.
- La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo explique comment les pays se spécialisent dans la production de biens pour lesquels ils sont les plus efficaces.
- Les différences de dotations factorielles (travail, capital) et technologiques entre les pays influencent leurs avantages comparatifs.
- Le commerce entre pays comparables est motivé par la différenciation des produits, les différences de qualité et la fragmentation de la chaîne de valeur.
Introduction au commerce international [0:00]
Le commerce international joue un rôle crucial dans l'économie mondiale, représentant 30 milliards de dollars, soit 30 % du PIB mondial. Contrairement à il y a 500 ans, où la production était principalement consommée localement, les échanges internationaux ont considérablement augmenté, surtout entre 1850 et 1900, puis entre 1970 et 2008. Un échange commercial international se produit lorsqu'un bien traverse une frontière pour être vendu, impliquant un importateur (acheteur) et un exportateur (vendeur). Les économistes cherchent à comprendre pourquoi les pays échangent des biens, en particulier entre des pays aux caractéristiques différentes.
Avantages comparatifs : Théorie de Ricardo [1:45]
En 1817, David Ricardo, inspiré par Adam Smith, a formulé la théorie des avantages comparatifs. Cette théorie stipule qu'un pays a un avantage comparatif dans la production d'un bien s'il le produit le mieux par rapport aux autres pays, ou le moins mal. Chaque pays a donc intérêt à se spécialiser dans la production du bien pour lequel il possède cet avantage. Par exemple, si le Portugal produit du vin à moindre coût que l'Angleterre, il doit se spécialiser dans le vin, tandis que l'Angleterre se spécialise dans le drap, où elle est relativement plus efficace. Même si un pays est meilleur dans tout, il doit se spécialiser dans ce qu'il fait le mieux. La spécialisation entraîne automatiquement du commerce international, car les pays doivent importer les biens qu'ils ne produisent plus.
Origine des avantages comparatifs : Dotations factorielles et technologiques [5:20]
Les avantages comparatifs découlent des différences entre les pays, notamment leurs dotations factorielles (quantité de facteurs de production disponibles) et leurs dotations technologiques. Un pays avec une forte dotation en facteur travail aura un coût de travail faible, ce qui le rendra compétitif dans les industries nécessitant beaucoup de main-d'œuvre. Par exemple, la Chine, avec une abondance de travailleurs, se spécialise dans la production de vêtements, tandis que l'Allemagne, avec beaucoup de capital, se spécialise dans les machines industrielles. De même, les différences de dotations technologiques peuvent donner un avantage comparatif dans la production de biens complexes.
Commerce entre pays comparables : Différenciation et qualité des produits [9:32]
Le commerce ne se limite pas aux pays différents ; les pays comparables échangent aussi des biens. Cela s'explique par trois facteurs principaux. Premièrement, la différenciation des produits : les consommateurs recherchent des biens qui correspondent à leurs goûts personnels, ce qui encourage le commerce de produits similaires mais différenciés (par exemple, une Polo allemande et une Clio française). Deuxièmement, la différence de qualité : les consommateurs souhaitent avoir le choix entre différentes qualités de produits, ce qui stimule le commerce de biens de qualité variable (par exemple, une Alpha Romeo italienne et une Peugeot française).
Fragmentation de la chaîne de valeur et commerce international [12:23]
Troisièmement, la fragmentation de la chaîne de valeur : les étapes de fabrication d'un bien sont réparties dans différents pays, ce qui crée un commerce de biens intermédiaires. Par exemple, les composants d'un ordinateur portable peuvent être fabriqués en Inde, en Thaïlande et en Chine, puis assemblés aux Philippines. Cette fragmentation a considérablement augmenté le commerce international depuis les années 1970.