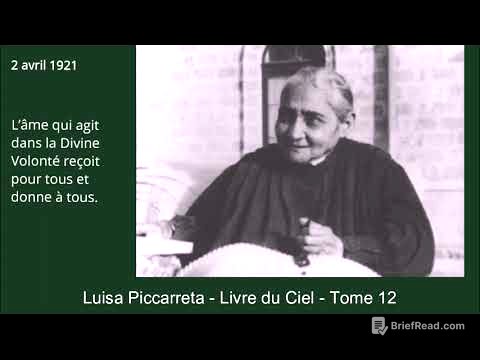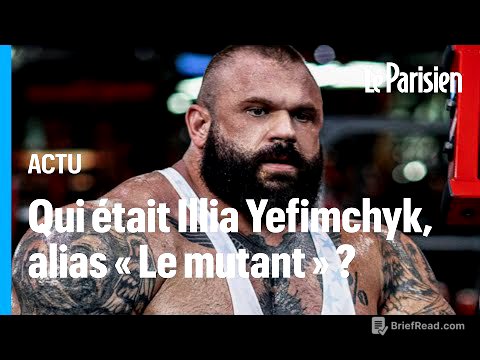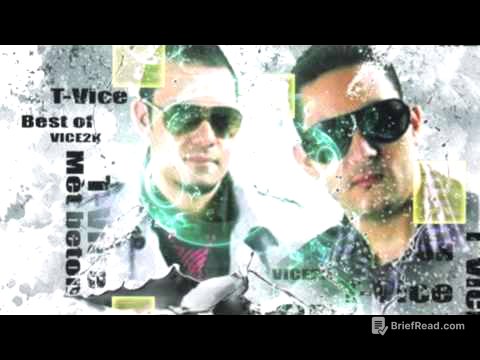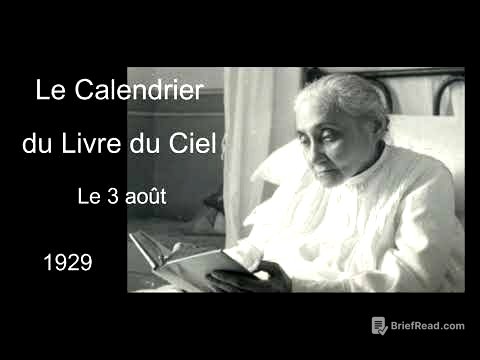Bref Résumé
Cette vidéo explore l'engagement politique dans les sociétés démocratiques, en examinant comment les caractéristiques socio-démographiques influencent cet engagement. Elle aborde également l'évolution des objets de l'action collective, des acteurs impliqués et des répertoires d'action utilisés.
- L'engagement politique varie selon le niveau de diplôme, la catégorie sociale, l'âge et le sexe.
- Les actions collectives ont évolué, passant des conflits du travail aux luttes pour de nouveaux droits et les causes minoritaires.
- Les acteurs des actions collectives se sont diversifiés, avec l'émergence de groupements de citoyens spontanés.
- Le répertoire de l'action collective s'est élargi avec l'intégration de nouvelles formes d'action comme les occupations de sites et l'utilisation d'Internet.
L'influence des caractéristiques socio-démographiques sur l'engagement politique [0:09]
Les caractéristiques socio-démographiques d'un individu influencent sa probabilité de s'engager politiquement. Par exemple, les personnes plus diplômées sont plus susceptibles de s'engager dans des associations que celles ayant un niveau de diplôme inférieur. De même, les individus appartenant aux catégories socio-professionnelles favorisées, comme les cadres, s'engagent plus souvent que les ouvriers. Les sociologues expliquent cela par un plus grand sentiment de compétence politique chez les cadres et les plus diplômés, qui ont l'impression de mieux comprendre les enjeux politiques. L'âge joue également un rôle, les générations plus anciennes étant plus engagées que les plus jeunes, en raison d'une plus grande méfiance des jeunes envers le monde politique. Enfin, bien que les hommes et les femmes s'engagent autant, ils le font différemment : les hommes sont plus présents dans les partis politiques, tandis que les femmes s'investissent davantage dans les associations humanitaires.
L'évolution des objets de l'action collective [4:01]
Depuis le 19e siècle jusqu'aux années 1980, les actions collectives étaient principalement axées sur la qualité des emplois, avec des revendications salariales et des améliorations des conditions de travail. Ces actions sont qualifiées de conflits du travail. À partir des années 1990, on observe une diminution des conflits du travail et l'émergence de nouveaux enjeux de mobilisation, notamment la lutte pour de nouveaux droits et la défense des opinions. Les luttes écologiques et les luttes minoritaires, visant à défendre les droits des minorités, gagnent en importance. La diffusion du hashtag #MeToo et les manifestations antiracistes sont des exemples de ces nouvelles formes de mobilisation.
La transformation des acteurs de l'action collective [6:14]
Jusque dans les années 1980, les actions collectives étaient principalement organisées par les syndicats, les partis politiques (comme le Parti communiste) et certaines associations (comme la Croix-Rouge). À partir des années 1980, on assiste à l'émergence de groupements de citoyens, qui se rassemblent spontanément pour défendre une cause sans l'implication de ces acteurs traditionnels. Ces groupements se caractérisent par l'absence de hiérarchie et leur nature temporaire, disparaissant une fois leur revendication satisfaite. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes est un exemple typique de groupement de citoyens.
L'élargissement du répertoire de l'action collective [8:36]
Le répertoire de l'action collective désigne l'ensemble des types d'actions que les militants peuvent utiliser pour protester. Avant 1980, les principales formes d'action étaient la manifestation et la grève. Après 1980, le répertoire s'est élargi et diversifié, intégrant de nouveaux modes d'action tels que les occupations de sites (comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes) et les actions liées à l'essor d'Internet, comme les dénonciations sur les réseaux sociaux (avec le hashtag #MeToo) et le hacktivisme.