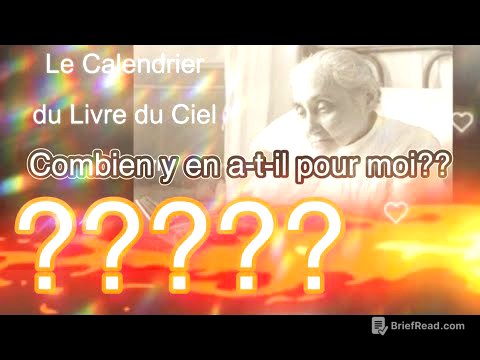Bref Résumé
Cette vidéo explore les différentes formes d'engagement politique dans les sociétés démocratiques et les raisons pour lesquelles les individus participent à des actions collectives. Elle aborde le vote, le militantisme (au sein de partis politiques, de syndicats et d'associations), et la consommation engagée. La vidéo examine également le paradoxe de l'action collective, où la participation individuelle semble irrationnelle, et explique comment les incitations sélectives, les rétributions symboliques et une structure d'opportunités politiques favorable peuvent encourager l'engagement.
- Les trois formes d'engagement politique sont le vote, le militantisme et la consommation engagée.
- Le paradoxe de l'action collective suggère qu'il est irrationnel de participer à une action collective.
- Les incitations sélectives, les rétributions symboliques et une structure d'opportunités politiques favorable encouragent l'engagement.
Les Formes d'Engagement Politique [0:00]
Dans les sociétés démocratiques, l'engagement politique prend de nombreuses formes, allant du simple vote à des actions plus actives. Toute action visant à défendre une valeur politique, comme la liberté, l'égalité ou la justice, est considérée comme une forme d'engagement. Pour le bac, il est essentiel de connaître les trois principales formes d'engagement : le vote, le militantisme et la consommation engagée.
Le Vote [0:26]
Le vote est une forme d'engagement politique qui consiste à participer à une élection organisée par les pouvoirs publics. En déposant un bulletin dans l'urne, le citoyen exprime une opinion politique, que ce soit en choisissant un candidat ou en votant blanc pour manifester son insatisfaction.
Le Militantisme [0:48]
Le militantisme implique la participation active à la défense d'une cause spécifique, comme la protection des animaux, l'égalité des sexes ou la défense de l'environnement. Les militants peuvent s'engager dans diverses activités, telles que la distribution de tracts, le collage d'affiches, la participation à des manifestations ou des grèves. Ils sont souvent membres d'organisations telles que des partis politiques, des syndicats ou des associations. Les partis politiques visent à remporter des élections, les syndicats à défendre les intérêts des travailleurs, et les associations à promouvoir des causes spécifiques.
La Consommation Engagée [2:27]
La consommation engagée se manifeste lorsqu'un individu choisit d'acheter ou de ne pas acheter un produit dans le but d'influencer les entreprises qui le produisent. Le plus souvent, cela prend la forme d'un boycott, où les consommateurs refusent d'acheter certains produits pour exprimer leur désaccord avec les pratiques de l'entreprise. Par exemple, les végétariens ne consomment pas de viande pour dénoncer la souffrance animale, et certains consommateurs évitent les marques de vêtements accusées d'exploiter des travailleurs en Asie.
Le Paradoxe de l'Action Collective [3:05]
La participation à une action collective soulève la question de savoir pourquoi les individus s'engagent dans de telles actions. Selon Mancur Olson, il est irrationnel de participer à une action collective. Olson soutient que les individus font un calcul coût-bénéfice avant de s'engager. Si les coûts de la participation sont supérieurs aux gains, ils ne participent pas. Cependant, Olson souligne que même si une action collective réussit, les bénéfices sont partagés par tous, y compris ceux qui n'ont pas participé. Cela crée un paradoxe : si tout le monde se comporte de manière rationnelle et attend que les autres agissent, personne ne se mobilisera, et aucune action collective n'aura lieu.
Les Raisons de l'Engagement Collectif [5:22]
Malgré le paradoxe de l'action collective, les individus participent parfois à des actions collectives. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet engagement. Premièrement, les organisations qui organisent des actions collectives offrent des incitations sélectives, comme des repas gratuits ou une assistance juridique, pour encourager la participation. Deuxièmement, les individus peuvent être motivés par des rétributions symboliques, comme le sentiment d'appartenance à un groupe ou la satisfaction de donner un sens à leur vie. Enfin, l'engagement est plus probable lorsque la structure des opportunités politiques est favorable, c'est-à-dire lorsque l'État est tolérant à l'égard des actions collectives, que les participants ont des alliés influents et que l'État est capable de répondre positivement aux revendications. De plus, des divisions politiques et des élections imminentes peuvent créer un contexte favorable à l'engagement.